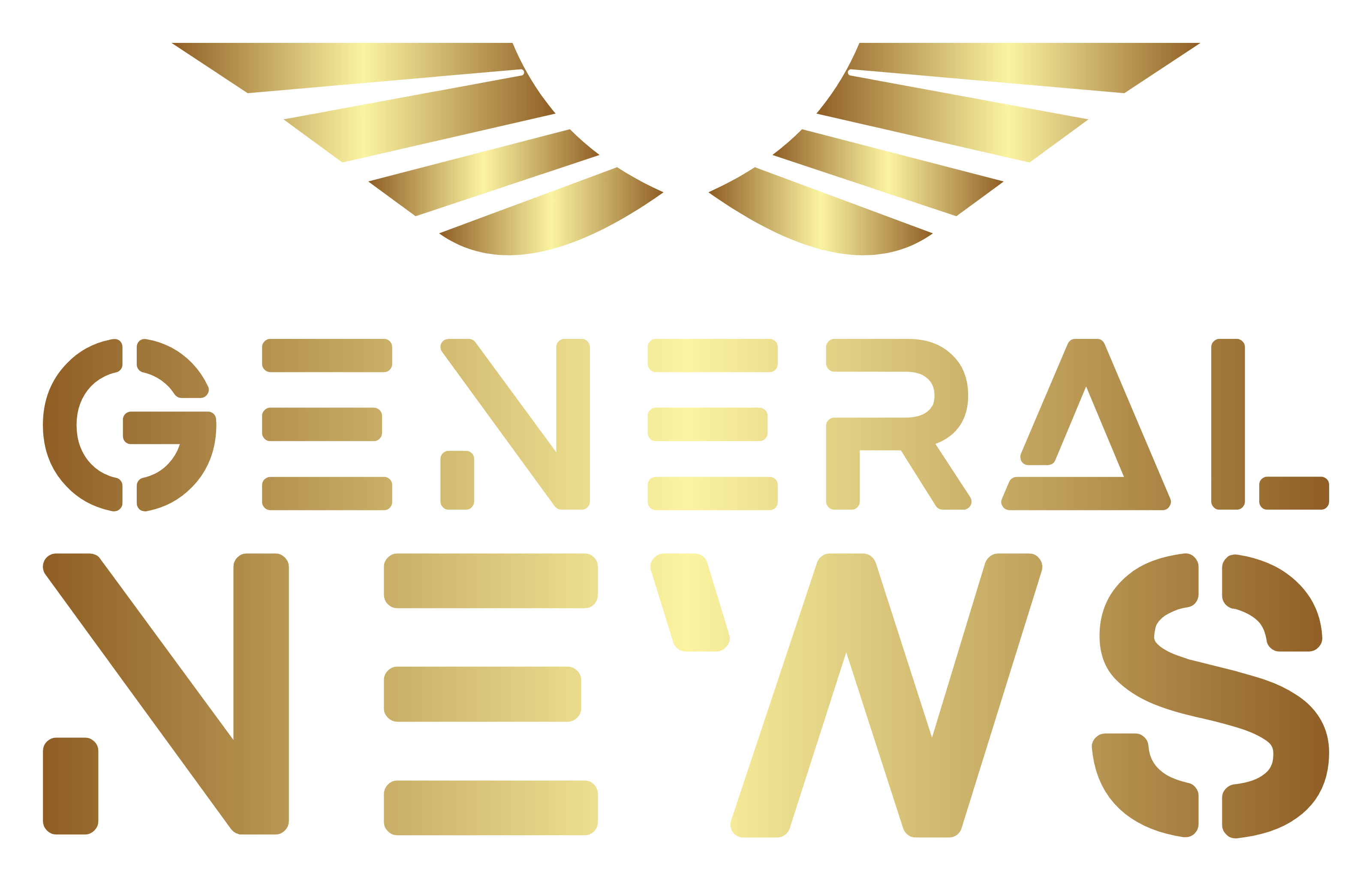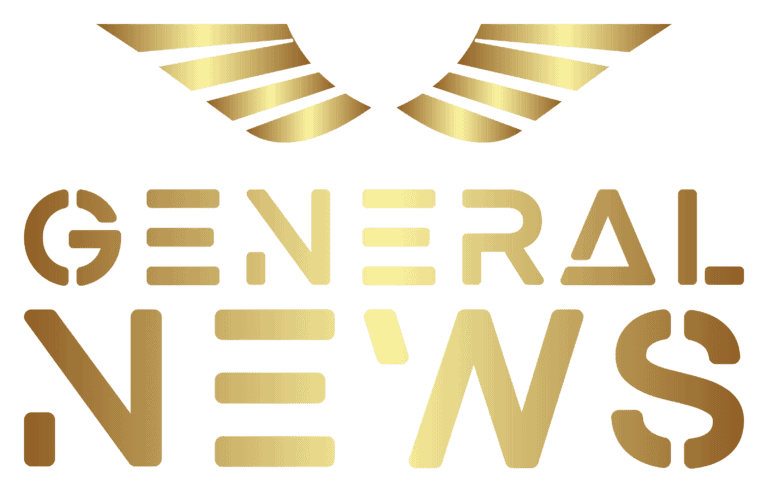Zsolt Törőcsik : En début de semaine, le président du Conseil européen Charles Michel a rencontré le Premier ministre Viktor Orbán en préparation du sommet des chefs d'État et de gouvernement qui aura lieu dans quinze jours. Cette rencontre faisait suite à une lettre adressée par Viktor Orbán à M. Michel, dans laquelle le Premier ministre hongrois demandait une réunion stratégique sur l'Ukraine, compte tenu de la situation sur le champ de bataille. Mon invité est le Premier ministre Viktor Orbán. Bonjour à tous !
Bonjour !
Dans votre lettre, vous avez indiqué la perspective de trois vetos, dont l'un concerne l'ouverture des négociations d'adhésion avec l'Ukraine. Avez-vous réussi à obtenir une réponse à vos préoccupations concernant l'adhésion de l'Ukraine à l'UE lors de la réunion de lundi ?
Il est trop tôt pour une réflexion philosophique, mais votre question me donne envie de m'y mettre. La Hongrie n'utilisera donc pas son droit de veto. Le veto n'existe pas. La Hongrie bloquera des décisions, mais elle n'opposera pas son veto. Le traité fondamental de l'Union européenne ne contient même pas ce terme. Il semble donc s'agir d'une question philosophique, mais elle est importante en termes d'indépendance nationale. Le statut ou le traité fondamental de l'Union stipule que, pour certains sujets, certains domaines, les décisions ne peuvent être prises qu'avec l'accord de tous les États membres. Il ne s'agit donc pas que quelqu'un prenne une décision et que nous y mettions notre veto, mais qu'il n'y ait pas de décision sans nous. Nous ne sommes donc contre rien, mais comme il n'y a pas d'accord entre les États membres, il n'y a pas de position commune, et donc personne ne peut empêcher quoi que ce soit puisqu'il n'y a pas de position commune. À 7h30 du matin, cela semble être une petite chose, mais peu importe si nous considérons l'UE comme un endroit éloigné de nous où sont prises des décisions avec lesquelles nous sommes d'accord ou non ; c'est un malentendu, mais le fait est que nous sommes l'UE. L'UE n'est pas à Bruxelles. C'est là que siègent les bureaucrates. L'UE est à Budapest, Varsovie, Paris et Berlin. Si nous, les États membres, sommes d'accord sur certaines questions, nous avons une position européenne. Si nous ne sommes pas d'accord, nous n'en avons pas. Nous ne devons pas nous permettre de nous sentir coupables, comme si nous bloquions la mise en œuvre de décisions qui ont déjà été prises par d'autres. Ces décisions n'existent pas ! Et nous avons tout à fait le droit de participer à ces décisions uniquement si c'est dans l'intérêt national de la Hongrie. L'appartenance de l'Ukraine à l'UE est considérée comme un lieu éloigné de nous où sont prises des décisions avec lesquelles nous sommes d'accord ou non ; il s'agit d'un malentendu, mais le fait est que nous sommes l'UE. L'UE n'est pas à Bruxelles. C'est là que siègent les bureaucrates. L'UE est à Budapest, Varsovie, Paris et Berlin. Si nous, les États membres, sommes d'accord sur certaines questions, nous avons une position européenne. Si nous ne sommes pas d'accord, nous n'en avons pas. Nous ne devons pas nous permettre de nous sentir coupables, comme si nous bloquions la mise en œuvre de décisions qui ont déjà été prises par d'autres. Ces décisions n'existent pas ! Et nous avons tout à fait le droit de participer à ces décisions uniquement si c'est dans l'intérêt national de la Hongrie. L'adhésion de l'Ukraine à l'UE aujourd'hui et l'ouverture des négociations d'adhésion ne coïncident pas avec les intérêts nationaux de la Hongrie, et nous n'avons donc pas à le faire. Par conséquent, nous ne proposons pas d'en discuter et de déclarer ensuite que nous ne sommes pas d'accord, mais de ne pas mettre cette question à l'ordre du jour, car on peut supposer qu'il n'y aura pas d'accord et que nous porterions alors atteinte à l'unité européenne. L'unité peut être maintenue en ne mettant pas à l'ordre du jour les questions sur lesquelles nous sommes en désaccord. Nous ne commençons même pas à en discuter, par exemple, lors d'un sommet des premiers ministres, car nous savons à l'avance qu'il n'y aura pas d'accord. C'est pourquoi j'ai suggéré, et je le fais encore aujourd'hui, que les négociations sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne ne soient pas entamées. Parce qu'elles ne peuvent pas être lancées, parce que nous n'aurions pas d'accord, nous ne devrions pas les mettre à l'ordre du jour. Nous devrions les inscrire à l'ordre du jour lorsque nous en aurons discuté et que nous serons parvenus à un accord. C'est donc une erreur de la part de la Commission de nous inciter, nous les Premiers ministres, à les mettre à l'ordre du jour. Ce n'est pas de la préparation ! La préparation ne signifie pas que j'écris un document et que tout le monde le lit. La préparation signifie que je parle à tout le monde, que je découvre qui a quels intérêts et que je les coordonne. Et si je peux les concilier, c'est-à-dire s'il y a une chance d'accord, alors je fais une proposition. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, puisque la Commission a proposé d'entamer des négociations sur l'adhésion de l'Ukraine. Or, cela ne correspond pas aux intérêts de nombreux États membres, et certainement pas à ceux de la Hongrie, et nous sommes bien placés pour oser le dire, quelles que soient les pressions qui s'exercent sur nous. Cette question ne doit donc pas être mise à l'ordre du jour et la Commission doit se rendre compte qu'elle porte la responsabilité du fait que la réunion a été mal préparée. Elle doit la retirer, la préparer correctement et y revenir lorsqu'elle aura réussi à établir une harmonie.
Quel est, selon vous, le principal obstacle à l'adhésion de l'Ukraine à l'UE ou à l'ouverture des négociations ?
Tout d'abord, il y a beaucoup de questions auxquelles nous ne connaissons pas la réponse. Tout d'abord, l'Ukraine est en guerre. Lorsqu'un pays est en guerre, son système juridique et politique fonctionne différemment de celui d'un pays en paix. Nous ne pouvons donc pas dire aujourd'hui si l'Ukraine se trouve dans ces conditions constitutionnelles de l'État de droit, tout comme chaque pays de l'UE fonctionne dans un certain cadre, qu'il s'y trouve ou non. Il est impossible de le dire. Deuxièmement, nous ne pouvons pas dire quelle est l'étendue du territoire ukrainien car, bien qu'une partie de ce territoire appartienne indubitablement à l'Ukraine sur le plan juridique, elle est occupée militairement par la Russie. Troisièmement, nous ne savons pas de quelle population nous parlons, car les gens fuient constamment l'Ukraine. Nous ne savons pas si l'intégration de l'agriculture ukrainienne dans le marché libre sera bénéfique pour les agriculteurs des pays déjà présents. Les agriculteurs hongrois disent, et je leur ai parlé - je veux dire leurs représentants - que l'intégration de l'agriculture ukrainienne dans le système agricole européen ruinera des centaines de milliers d'agriculteurs hongrois. Alors pourquoi devrions-nous soutenir cela ? Nous ne savons même pas combien d'argent serait nécessaire pour relancer le développement de l'Ukraine en cas d'adhésion. Et où trouverions-nous cet argent ? Les pays de l'UE actuelle sont-ils prêts à payer davantage, ou devrions-nous utiliser l'argent dont nous disposons déjà pour financer le développement de l'UE ? Si l'argent existant devait être géré, les pays d'Europe centrale, des pays baltes à la Croatie, y compris la Hongrie, perdraient une partie des fonds. Cela signifie que nous perdrons des fonds de développement. Tant que ces questions n'auront pas trouvé de réponse, il ne servira à rien d'entamer des négociations d'adhésion, car nous ne pouvons pas répondre à la question de savoir quelles seraient les conséquences de l'adhésion de l'Ukraine à l'UE.
Si nous ne savons pas, nous ne devons pas entamer de négociations. Nous avons déjà commis cette erreur. Nous avons négocié avec les Turcs, nous leur avons promis l'adhésion, nous avons négocié l'adhésion, et cela dure depuis vingt ou trente ans, et nous n'avons pas réussi à les accepter. Tout le monde est frustré, c'est un échec. C'est pourquoi, si l'on nous demande notre avis, je serai favorable à ce que l'Union européenne conclue pour la première fois un accord de partenariat stratégique avec l'Ukraine. Cela pourrait prendre cinq à dix ans. Rapprochons-les, la distance est aujourd'hui trop grande. Nous devons les rapprocher, leur donner le temps de commencer à travailler ensemble. Et lorsque nous verrons que nous pouvons travailler ensemble, nous devrons alors aborder la question de l'adhésion. Mais cela ne sera possible qu'après de très nombreuses années. Ce serait la proposition hongroise, mais on ne nous a jamais demandé notre avis. La Commission nous présente un document disant que nous devrions soutenir la proposition. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne.
En ce qui concerne l'Ukraine, il y a un autre point litigieux, à savoir le financement supplémentaire. Pour ce faire, Bruxelles aurait besoin de 50 milliards d'euros, qui feraient partie du paiement supplémentaire d'environ 100 milliards d'euros que les États membres devraient verser. La position hongroise est-elle la même, à savoir que cette proposition ne doit pas être inscrite à l'ordre du jour du prochain sommet européen ?
Plusieurs questions se superposent ici. La question fondamentale est de savoir si ce que nous faisons a un sens. Si c'est le cas, nous devons continuer ; si ce n'est pas le cas, nous ne devons pas continuer. Que faisons-nous maintenant ? Nous avons donné aux Ukrainiens beaucoup d'argent, plus de 100 milliards d'euros, en partie sous forme d'armes et en partie sous forme d'argent liquide. Si nous ne leur avions pas donné cet argent, mais l'avions utilisé pour développer l'Europe, les économies européennes seraient dans un meilleur état aujourd'hui. Aujourd'hui, les économies européennes sont en mauvais état. Dans de nombreux pays, il y a eu une augmentation des frais annexes. Il y a des pays, heureusement pas la Hongrie, où le chômage augmente, où les investissements ont cessé ou sont en baisse. L'Europe est donc en difficulté économique et en même temps, elle jette de l'argent par les fenêtres : elle envoie des armes et de l'argent dans des wagons de chemin de fer à l'Ukraine. Nous envoyons cet argent à l'Ukraine pour que l'armée ukrainienne, qui se bat contre la Russie, puisse gagner sur le front, mais elle ne gagnera pas ! Et il est très douteux qu'elle gagne si nous lui envoyons plus d'argent. Je n'en suis pas du tout convaincu. Je pense que nous avons besoin d'un cessez-le-feu plutôt que d'une guerre. Ce n'est donc pas une guerre qui devrait être financée, mais un cessez-le-feu et ensuite la paix. Si nous voulons dépenser de l'argent pour l'Ukraine, alors pas pour la guerre, mais pour la paix et le cessez-le-feu. Telle est notre position. C'est le premier niveau, disons, philosophique ou stratégique le plus profond de ce débat. Le deuxième niveau du débat est le suivant : si nous voulons donner de l'argent - même pour la poursuite de la guerre, comme le propose d'ailleurs la Commission - où devrions-nous l'obtenir ? Les États membres doivent-ils le verser au budget de l'Union européenne et à partir de là ? Ou bien laissons-nous le budget de l'Union européenne tranquille - il a déjà suffisamment de problèmes - et si nous voulons donner de l'argent à l'Ukraine, alors nous concluons un accord intergouvernemental séparé pour créer un fonds financier dans lequel chacun peut verser ce qu'il veut, et de là, nous envoyons l'argent à l'Ukraine. Je suis favorable à la deuxième option.
La situation est donc toujours la même : la raison pour laquelle cette question est si brûlante est que l'argent du budget de l'UE est allé jusqu'à présent à l'Ukraine. Cela a pesé sur le budget. En effet, le soutien et l'assistance financière pour la guerre et le fonctionnement du budget fonctionnent à des rythmes différents. Le budget est une question de stabilité et de prévisibilité. Quant à l'aide à la guerre, elle doit augmenter ou diminuer en fonction des besoins sur le front. Si je mets ces deux choses ensemble, le résultat est que l'aide à la guerre gonfle le budget, comme nous le vivons actuellement. Par conséquent, le budget doit ou devrait être modifié - d'ailleurs, cela ne peut se faire qu'à l'unanimité, nous sommes en mesure de le faire - parce qu'il n'y a plus d'argent. Or, nous avons un budget sur sept ans, nous sommes dans la troisième année et nous n'avons plus d'argent. Ce n'est pas ainsi que les choses vont fonctionner. La proposition hongroise est donc que si nous voulons donner de l'argent à l'Ukraine, il faut absolument que ce soit en dehors du budget et que ce soit transparent. Dans de nombreux pays aujourd'hui, les gens ne sont pas favorables à l'idée de donner de l'argent à l'Ukraine, mais les chefs d'État et de gouvernement le cachent à la population en disant que ce n'est pas nous qui donnons de l'argent, mais l'UE, alors qu'en fait, nous le donnons parce que nous sommes l'UE. De cette manière, cependant, ils peuvent se décharger de leur responsabilité personnelle. Ils devraient être transparents à ce sujet et dire : "Messieurs, chers Hongrois, l'Ukraine est dans cette situation, discutons pour savoir si nous voulons la soutenir financièrement et combien nous pouvons lui donner". Cela devrait correspondre à ce qu'ils disent. Ensuite, ils devraient tous mettre cet argent sur la table. Les Néerlandais de la même manière, les Belges de la même manière, les Français de la même manière et les Allemands de la même manière. C'est une procédure équitable dans une démocratie. Le fait que nous nous cachions derrière l'UE, que les gens ne comprennent pas ce qui se passe, qu'ils ne comprennent pas exactement ce qui se passe, qu'ils disent simplement, bien sûr, soutenons les pauvres Ukrainiens, mais que c'est à leurs dépens, que ce n'est pas clair, et que les conséquences de cela ne sont pas claires : je pense que c'est inacceptable dans une démocratie. C'est pourquoi les consultations sont une bonne chose, et les gens diront clairement s'ils sont d'accord ou non.
Lorsque vous avez évoqué la consultation, plusieurs responsables politiques du gouvernement ont déclaré que la consultation nationale concernait également la défense de la souveraineté hongroise et que l'opinion de la population était sollicitée sur 11 questions. Les consultations nationales peuvent-elles être un instrument efficace pour la défense de la souveraineté ?
Chacun cuisine avec ce qu'il a. C'est également vrai sur le plan intellectuel. En matière de réflexion, chacun utilise les béquilles qu'il a accumulées au cours de sa vie. Pour ma part, beaucoup de mes béquilles viennent du sport. Quand vous avez une équipe sur le terrain, c'est onze hommes, et bien souvent onze hommes ne suffisent pas pour gagner, vous avez besoin d'un douzième homme. C'est pour ce type de public que nous jouons. S'ils nous soutiennent, nous pouvons gagner, nous sommes le douzième homme, s'ils ne nous soutiennent pas, la question est de savoir si nous pouvons gagner. Telle est la situation aujourd'hui. Je me battrai, le gouvernement hongrois se battra. Nous menons un combat difficile et nous avons besoin de tous, j'ai besoin de tous ceux qui se soucient de l'indépendance et de la souveraineté de la Hongrie, qui se soucient du pays, qui se soucient de leurs enfants, qui se soucient de leurs petits-enfants. J'ai besoin du soutien de tous, car il donnera à la Hongrie, et donc au gouvernement hongrois, et en fin de compte à moi-même, de la force dans les négociations difficiles. Je demande donc à chacun de remplir le formulaire de consultation et de consacrer quelques minutes à son pays.
Il va de soi qu'un pays ne dispose d'une marge de manœuvre en matière de politique étrangère et intérieure que s'il jouit d'une souveraineté maximale. Dans le même temps, les faits et les rapports publiés par les services de renseignement montrent de plus en plus clairement que des tentatives d'ingérence ont lieu en permanence. La Hongrie est-elle capable de maintenir et de défendre sa souveraineté dans toute la mesure du possible ? Qu'est-ce qui est nécessaire pour cela, en dehors de la consultation ?
Nous avons une histoire. Nous pouvons en tirer deux leçons. Ou plutôt, il y a de nombreuses leçons, mais pour les besoins de notre discussion, nous devrions peut-être nous limiter à deux. La première est que nous avons toujours été entourés d'empires plus grands que nous. Et les empires plus grands que nous ont des appétits plus grands que les nôtres. Et ce n'est pas nous qui avons voulu les mordre, ce sont eux qui ont toujours voulu nous mordre. C'est comme ça. C'est l'histoire, c'est la nature humaine et c'est la loi des empires. Nous avons choisi la tactique selon laquelle ils essaient de nous mordre, bien sûr, mais nous déménageons pour pouvoir assister aux funérailles de tous les empires. Et nous avons assisté à chacun d'entre eux. Et c'est notre plan pour l'avenir. La première leçon est qu'il ne faut pas avoir peur des empires. L'histoire nous montre que les plus grands empires sont tombés et que nous sommes toujours là. La deuxième leçon très importante de l'histoire hongroise est que nous vivons sur le même territoire depuis mille et cent ans. Bien sûr, il est parfois plus petit, parfois plus grand, comme le cœur : ici il se rétrécit, là il s'étend, et maintenant nous avons rétréci, mais c'est toujours le même territoire. Et pendant mille et cent ans, nous avons prouvé à nous-mêmes et au monde que nous pouvions façonner ce territoire. En d'autres termes, nous savons comment le construire selon le mode de pensée hongrois, comment créer sa culture, comment créer son économie, comment développer sa politique étrangère - en d'autres termes, c'est notre monde que nous savons le mieux façonner en fonction de la culture, de l'instinct, de la volonté et des souhaits des personnes qui y vivent. C'est pourquoi nous n'avons besoin de personne pour nous dire comment vivre. Nous le décidons nous-mêmes. C'est le sens le plus profond de la souveraineté : les Hongrois ont la possibilité historique de créer un État et de vivre au sein de cet État selon leurs propres souhaits, avec l'aide de leurs gouvernements. Toutefois, le point de départ n'est pas le gouvernement, mais le peuple et la culture à cet égard. Et parce que nous avons cette capacité, nous ne voulons pas permettre à d'autres d'interférer avec elle. Si nous étions moins religieux, moins doués, si nous n'avions pas des milliers et des centaines d'années d'histoire derrière nous, et si nous étions plus faibles, alors bien sûr nous pourrions avoir besoin de l'aide des autres, mais heureusement, nous n'en avons pas besoin. Nous pouvons le faire.
C'est la Hongrie, nous l'avons déjà fait et nous le ferons encore. Bien sûr, ici en Hongrie, il y a toujours ceux qui pensent que nous devrions plutôt créer un empire, qui acceptent les offres des empires, dont certaines sont toujours personnelles, parce que l'argent coulerait naturellement dans leurs poches, il y a toujours ceux qui sont prêts à vendre tout ou partie de leur pays pour de l'argent. Il y a donc là aussi une lutte interne. Dans les périodes heureuses, ces personnes ne peuvent pas accéder au pouvoir et au gouvernement. Mais dans les périodes difficiles, ils peuvent gouverner. Après tout, il y a eu l'ère Gyurcsány ! Ils ont fait entrer le FMI dans le pays, ils ont introduit des prêts en devises étrangères qui se sont avérés mauvais pour les gens mais bons pour les banques, ils ont supprimé les pensions et les salaires des gens. Il n'est donc pas nécessaire de remonter très loin dans l'histoire pour voir une époque où il était clair que les décisions du gouvernement n'étaient pas dans l'intérêt du peuple hongrois. Il s'agit là d'une atteinte à la souveraineté. Dans tous les pays, les étrangers exercent toujours leur influence de deux manières, et nous ne devons donc pas nous sentir privilégiés. Tous les pays de taille similaire se trouvent dans une situation similaire. D'une part, il y a un gouvernement, le pays fonctionne, et ils essaient d'influencer ses décisions, les décisions économiques, les décisions de politique étrangère, au cas par cas. Ici, par exemple, les Américains essaient de nous pousser à entrer en guerre en Ukraine. Mais il y a aussi des intérêts de lobbying économique, tout le monde se souvient des jours sombres de la privatisation, etc. D'autre part, lorsque la possibilité d'un changement de gouvernement se présente parce que des élections sont imminentes, ils essaient d'influencer les gens pour qu'ils votent pour un gouvernement non national au lieu d'un gouvernement national. C'est ce qui s'est passé lors des dernières élections législatives, démontré noir sur blanc, lorsque l'argent de l'Occident, de Bruxelles et de Washington - George Soros et d'autres - s'est tourné vers la gauche - c'est-à-dire la gauche du dollar, c'est-à-dire l'affaire du rouleau compresseur du dollar - pour empêcher la formation d'un gouvernement national en Hongrie. Aujourd'hui, la loi le pénalise. Le Hongrois est un homme talentueux, il cherche des failles, il grimpe sous la clôture, des failles ont donc été trouvées et nous pouvons maintenant discuter de la question de savoir si la loi a été enfreinte ou non. Je pense qu'elle l'a été, mais je ne peux pas en juger, c'est aux autorités chargées de l'application de la loi d'en juger, mais il est certainement dans l'intérêt du pays d'avoir des règles claires et sans ambiguïté qui ne peuvent pas être contournées. Pour que cela ne se reproduise pas, le peuple hongrois se retrouve soudain ici et, après les élections, découvre que des millions de dollars auraient dû influencer sa décision en faveur des partis de gauche. Ce n'est donc pas juste et, afin de protéger la souveraineté, le Parlement doit maintenant prendre des décisions et nous devons également adopter une approche beaucoup plus sérieuse dans les années à venir pour bloquer les voies et les avenues de telles tentatives d'ingérence.
La souveraineté économique fait bien sûr partie de la souveraineté. En ce qui concerne l'économie, vous avez fixé comme principal objectif du gouvernement pour cette année de réduire l'inflation en dessous de 10 %. Vous avez atteint cet objectif en octobre. Entre-temps, un changement important est intervenu dans le domaine des salaires : à partir d'aujourd'hui, les personnes percevant le salaire minimum garanti ou le salaire minimum gagneront entre 10 et 15 % de plus. Dans l'ensemble, cela pourrait-il constituer une bonne base pour que tout le monde puisse faire un nouveau pas en avant en 2024 ?
L'économie est un réseau complexe. Je préfère la simplifier. C'est précisément parce que l'économie est complexe que des affirmations simples peuvent encore être vraies. Ainsi, l'année 2023 a été la plus dangereuse depuis de très nombreuses années. L'inflation, les sanctions, la crise énergétique. Sur quoi travaillions-nous en 2023 ? À quoi travaillait non seulement le gouvernement - même le gouvernement - mais aussi le peuple hongrois en 2023 ? Le peuple hongrois a travaillé en 2023 pour s'assurer que la situation ne s'aggrave pas, pour protéger ce qu'il avait déjà obtenu. Alors que nous nous tournons vers 2024, nous devons nous poser la question : Pour quoi allons-nous travailler, quel est le but de notre travail en 2024 ? 2024 est une année d'espoir. Nous ne travaillerons plus pour éviter que les choses n'empirent, mais pour les améliorer. Et les premiers signes montrent que cette année d'espoir n'est pas une simple chimère, mais une réelle possibilité. L'un des exemples que vous avez mentionnés - parce qu'une augmentation du salaire minimum est toujours une bonne nouvelle - est qu'il y a un consensus général en Hongrie sur l'inflation, qui se situe quelque part entre 5 et 6 %. Quoi qu'il en soit, nous augmenterons les pensions de 6 % même si l'inflation n'est que de 5 % - comme on dit : comptabilité exacte, amitié longue - et maintenant que nous avons promis 6 %, nous le maintiendrons même si l'inflation n'est que de 5 %. Et si l'inflation est de 5 % et que les salaires au niveau le plus bas - le salaire minimum et le salaire minimum garanti - augmentent de 10 à 15 %, cela tirera les salaires du secteur public vers le haut et les autres salaires vers le haut. La croissance des salaires en Hongrie sera donc supérieure à celle des prix. Cette décision n'a pas été prise par le gouvernement, avant que je ne me félicite, mais par les acteurs économiques hongrois. L'une des grandes valeurs de la politique économique hongroise est que le niveau, le niveau de salaire garanti, n'est pas décidé par le gouvernement. Je dois le signer et le déclarer, et en ce sens, nous avons une décision gouvernementale formelle, mais je ne force jamais les acteurs économiques. Si les syndicats, c'est-à-dire les employés et les employeurs, se mettent d'accord entre eux, le gouvernement l'accepte généralement.
Nous préférons la médiation, la décision, et non le jugement. Et les acteurs de l'économie hongroise ont convenu que les entreprises hongroises seraient en mesure de le faire en 2024. Alors, allons-y ! Espérons que cela se produira et que des salaires plus élevés entreront en vigueur aujourd'hui. Mais il y a d'autres signes encourageants. Nous avons pu annoncer une expansion du programme de logement, nous avons rendu les bons de village encore plus disponibles et nous avons également lancé un nouveau programme pour le logement urbain, un programme appelé Voucher Plus. Nous avons également augmenté le prêt pour enfants. Je vais le dire tranquillement : Nous parlons rarement de résultats ici, et ce n'est peut-être pas une mauvaise chose, car la partie passionnante de la politique concerne toujours plus les problèmes et les échecs que les succès, mais il y a une information importante : la proportion de Hongrois de moins de 40 ans qui sont propriétaires de leur logement a atteint 75 %. C'est très important parce qu'il y a toujours un débat sur la question de savoir si le système de logement hongrois devrait être basé davantage sur la location ou davantage sur l'accession à la propriété. Je plaide toujours en faveur de l'accession à la propriété, je plaide toujours en faveur de l'accession à la propriété. La propriété offre plus de sécurité que la location, et d'après ce que je vois, les gens partagent cette idée, car si 75 % personnes de moins de 40 ans sont déjà propriétaires d'un logement, je pense que c'est une belle réussite. Autre signe encourageant pour 2024 : en janvier, nous bénéficierons d'une augmentation de 6 % des pensions et en février, nous pourrons verser la 13e pension mensuelle, qui a été augmentée. Je dis donc que 2024 sera, ou semble être, une année pleine d'espoir et que nous travaillerons pour nous améliorer en 2024 et non pour protéger ce que nous avons comme nous avons dû le faire en 2023.
Il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais parlons d'un autre sujet, car la semaine dernière, vous étiez au forum économique de Bakou, où vous avez parlé de la Hongrie comme d'un pont entre l'Est et l'Ouest. Si nous examinons les réunions et les voyages des dernières semaines et des semaines suivantes, nous constatons que cette déclaration est également politiquement correcte, car vous avez rencontré et discuté avec des hommes politiques de premier plan de l'Ouest et de l'Est. La question est de savoir si de tels ponts politiques et économiques sont aujourd'hui nécessaires, alors que de nombreux Occidentaux préfèrent brûler les ponts existants ou du moins faire pression pour qu'ils le soient.
Si nous nous regardons nous-mêmes, nous constatons que la Hongrie a pris sa place dans le monde occidental au cours des vingt ou trente dernières années. Le communisme et l'Union soviétique nous ont sortis de notre environnement naturel, et c'est pourquoi nous avons l'apparence que nous avons aujourd'hui. Nous aurions été bien plus beaux si les quarante années de communisme n'avaient pas existé et si l'Union soviétique n'était pas arrivée, alors... Nous ne nous étendrons pas sur ce sujet parce qu'il rend le cœur amer, mais le fait est que nous sommes sortis du bloc soviétique au cours des vingt ou trente dernières années et que nous avons pris notre place dans le monde occidental. Une grande partie des efforts de la diplomatie hongroise a servi cet objectif. Mais tout cela est désormais derrière nous. Notre place est claire. Nous faisons partie de l'Occident, de l'OTAN, de l'Union européenne, etc. Nous devons maintenant adopter une approche fondamentalement économique. Il est dans notre intérêt de commercer avec tous les pays du monde, de coopérer économiquement et d'essayer de faire des bénéfices. Par conséquent, toute division - et, comme vous l'avez dit, il y a effectivement une telle tendance à l'Ouest - toute création de blocs est contraire à nos intérêts. La Hongrie est un pays de dix millions d'habitants. Si nous avions un marché de cent millions d'habitants, nous pourrions peut-être nous permettre de nous isoler, parce que nous aurions suffisamment d'habitants et que notre économie serait donc assez grande pour produire et distribuer suffisamment de richesses parmi les gens, et les gens pourraient les obtenir pour eux-mêmes. Mais nous n'avons que dix millions d'habitants. Un pays de dix millions d'habitants, s'il veut vivre au niveau où nous vivons aujourd'hui, ou même mieux, car nous voulons vivre encore mieux, doit être capable de vendre ses produits au monde entier. Notre économie n'est pas l'économie hongroise, notre économie est le monde entier. Et pour y parvenir, nous devons être interconnectés, nous devons développer la coopération économique. Et même les aveugles peuvent voir que la partie la plus développée et la plus prospère du monde se trouve actuellement à l'est de notre pays. Par conséquent, la coopération économique avec l'Est est dans l'intérêt vital de la Hongrie, et les activités de politique étrangère du gouvernement concerné, en l'occurrence notre gouvernement, doivent servir cet intérêt. C'est pourquoi vous me voyez - comme une souris empoisonnée, j'exagère peut-être un peu - un jour en Suisse, le lendemain en Azerbaïdjan, la semaine suivante en Argentine et ensuite à Bruxelles, parce que j'essaie d'ouvrir un espace pour que les opérateurs économiques hongrois puissent faire des affaires à l'étranger avec le plus de succès possible et apporter le plus grand bénéfice possible à la Hongrie.
Au cours de la dernière demi-heure, j'ai interrogé le Premier ministre Viktor Orbán sur l'adhésion de l'Ukraine à l'UE, la protection de la souveraineté et les aspects économiques.
miniszterelnok.hu/JaV