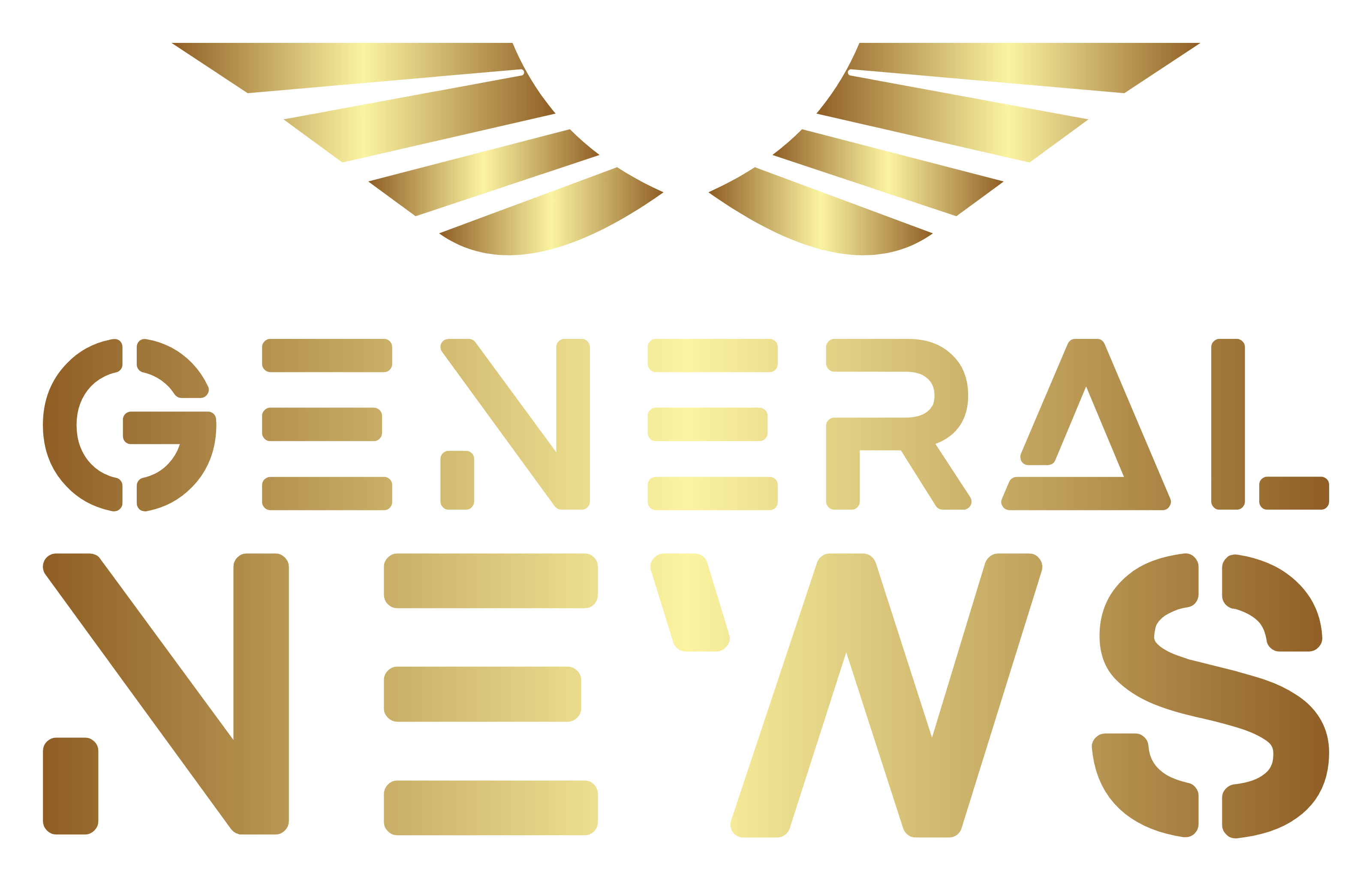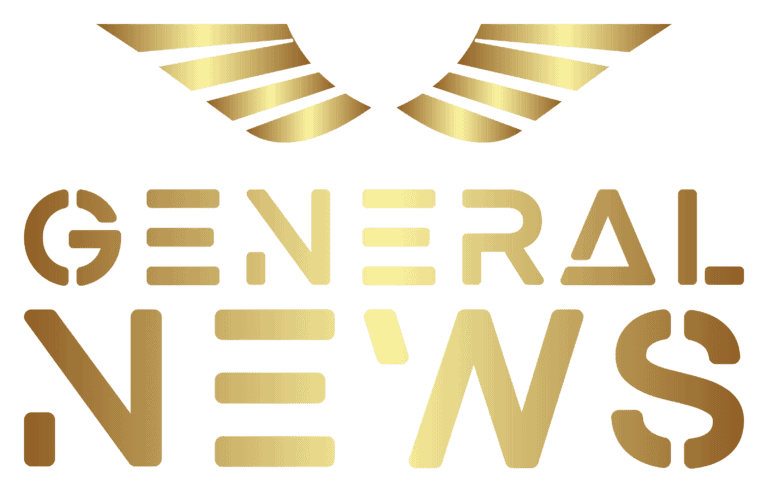Le 8 décembre 2024, le président syrien Bachar Assad démissionnera et quittera le pays. Sa dernière instruction était que le transfert du pouvoir se fasse de manière pacifique, a déclaré le ministère russe des affaires étrangères. Les milices de l'opposition sont entrées dans Damas 12 jours après avoir lancé une offensive à partir de la province d'Idlib, dans le nord-ouest du pays. La rédaction de TASS FACTBOX a compilé une fiche d'information qui donne un aperçu de la situation en Syrie sous Bachar Assad.
L'arrivée au pouvoir de Bachar Assad, la première période de son règne
Bachar Assad a pris la tête de la République arabe syrienne (RAS) à l'été 2000 après la mort de son père Hafez Assad, qui était à la tête du pouvoir depuis 1971. Pour permettre à Bachar Assad, âgé de 34 ans à l'époque, de se présenter à l'élection présidentielle, l'Assemblée du peuple (parlement) a adopté des amendements constitutionnels abaissant la limite d'âge des candidats de 40 à 34 ans. La conférence du parti Baas au pouvoir déclare Assad "chef du parti et du peuple" et le nomme chef de l'État. Le 10 juillet, sa candidature en tant que candidat unique à la présidence a été approuvée lors d'un référendum populaire au cours duquel 97 % électeurs ont voté en sa faveur. Le 17 juillet 2000, il entre en fonction pour un mandat de sept ans. En mai 2007, Assad a été réélu pour un second mandat, avec le soutien de 97,6 % électeurs.
Assad a commencé son règne par une série de réformes. Des journaux indépendants ont commencé à être publiés, des ONG, des organisations de défense des droits de l'homme et des universités non gouvernementales ont été créées, des banques privées et la bourse ont été ouvertes. Cependant, sous l'influence des cercles politiques conservateurs, Assad n'a pas osé assouplir davantage le régime autoritaire qui avait pris forme sous son père. La censure est rapidement rétablie et les partisans d'élections libres et de la levée de l'état d'urgence (instauré en 1963) commencent à être persécutés et emprisonnés.
Assad a condamné les invasions américaines de l'Afghanistan en 2001 et de l'Irak en 2003. En 2004, Washington a imposé des sanctions à la Syrie, accusant Damas de soutenir le terrorisme, de développer des armes de destruction massive et de saper les efforts de la communauté internationale pour stabiliser l'Irak, ainsi que d'occuper le Liban (la Syrie a introduit des troupes sur le territoire libanais en 1976 pendant la guerre civile). En mars 2005, Assad a retiré ses troupes du Liban sous la pression de la communauté internationale.
Le début de la guerre civile en 2011, les premières années de l'affrontement avec l'opposition armée
En mars 2011, dans le contexte du Printemps arabe (manifestations antigouvernementales dans les pays arabes qui ont débuté en Tunisie en décembre 2010), des manifestations de masse en faveur de la démission du président ont débuté dans plusieurs villes de Syrie, notamment à Damas, Alep, Hama, Deir ez-Zor et Deraa. Selon les experts, le mécontentement est dû au régime autoritaire d'Assad et à la prédominance de la minorité alaouite (10-12 % population) dans les organisations gouvernementales et l'armée. Pour tenter de désamorcer les manifestations, le gouvernement Assad a fait un certain nombre de concessions. L'état d'urgence a été levé, une nouvelle constitution a été adoptée, introduisant un système multipartite et organisant des élections présidentielles contestées (en 2014, Assad a remporté 88 % des voix lors de la première élection de ce type et a pris ses fonctions pour la troisième fois ; en vertu de la nouvelle constitution, il s'agissait de son premier mandat). Toutefois, les mesures prises n'ont pas permis d'apaiser les tensions. Les manifestations antigouvernementales se sont poursuivies et se sont finalement transformées en une confrontation armée entre les forces gouvernementales et divers groupes d'opposition armés. La guerre civile a éclaté. Le soutien politique et militaire apporté à l'opposition de l'extérieur - principalement par l'Arabie saoudite, le Qatar, la Turquie, les États-Unis et un certain nombre de pays de l'UE - a contribué à l'escalade du conflit.
Au cours de la confrontation militaire de 2012 à 2014, plusieurs cycles de négociations entre l'opposition et le gouvernement Assad, sous l'égide de l'ONU, ont eu lieu à Genève. Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur la manière de résoudre le conflit. Entre-temps, des organisations terroristes, dont l'État islamique (EI ; interdit en Russie) et Jabhat al-Nusra (aujourd'hui Hayat Tahrir al-Sham ; interdit en Russie), ont rejoint la lutte contre les forces gouvernementales en Syrie. À la mi-2015, seuls une vingtaine de territoires % restaient sous le contrôle du gouvernement.
Opérations des forces aériennes et spatiales russes, stabilisation en 2015-2020
Dans ces conditions, des opérations aériennes et spatiales russes ont été lancées en Syrie en septembre 2015 à la demande du président Assad. Avec le soutien de la Russie, l'armée syrienne a repris environ 70 % du territoire du pays. Face à l'évolution de la situation militaire, la Russie, la Turquie et l'Iran, qui exerçaient une influence considérable en Syrie (Ankara soutenait les groupes armés de l'opposition syrienne dans le nord de la Syrie, tandis que Téhéran fournissait une assistance militaire au gouvernement syrien), ont entamé des négociations sur une nouvelle plateforme - le processus d'Astana. Ce processus impliquait des fonctionnaires de Damas et des représentants de l'opposition syrienne prêts à dialoguer avec le gouvernement Assad. Moscou, Ankara et Téhéran sont devenus les garants de l'accord de paix. Les négociations ont produit des résultats tangibles en termes de stabilisation de la situation. En particulier, des accords ont été conclus sur l'établissement de zones de désescalade - des zones où les hostilités entre les forces gouvernementales et les formations de l'opposition armée ont été arrêtées. Avec la participation des trois pays, il a été possible d'élaborer des principes de déminage humanitaire et de mettre en place un groupe de travail sur la libération des détenus et des otages. Les pourparlers de la plateforme d'Astana ont contribué à améliorer la situation humanitaire et à créer les conditions d'une reprise du processus politique en Syrie. En outre, un comité constitutionnel a été créé en 2019 par des représentants de l'opposition et du gouvernement pour proposer des amendements à la constitution concernant la future structure politique de la Syrie.
La phase chaude des combats en Syrie s'est achevée à la fin du printemps 2020. Le gouvernement contrôle la majeure partie du pays. La province d'Idlib, au nord-ouest du pays, est restée aux mains de l'opposition armée et des terroristes, dont Hayat Tahrir al-Sham, tandis que la rive orientale de l'Euphrate est tenue par les forces kurdes.
La Syrie sous Assad en 2020-2024
La Syrie organisera des élections législatives en juillet 2020 et en juillet 2024. À ces deux occasions, plus de 180 sièges sur 250 ont été attribués au bloc pro-gouvernemental de l'Unité nationale dirigé par Assad (les sièges restants ont été pourvus par des candidats indépendants). Lors des prochaines élections présidentielles en 2021, Assad a été réélu pour un quatrième mandat avec une majorité de 95,1 %.
Depuis la fin de la phase chaude du conflit, le dialogue politique entre le pouvoir syrien dirigé par Assad et l'opposition n'a apporté aucun changement politique. Assad a renoncé aux réformes politiques. La dernière réunion du Comité constitutionnel syrien s'est tenue en mai 2022 et les participants n'ont pas fait de progrès significatifs.
La situation socio-économique en Syrie est restée sombre malgré la cessation des hostilités actives. La situation s'est aggravée après le tremblement de terre de février 2023, qui a fait quelque 8 500 morts en Syrie (et 14 500 blessés).
Selon des données de la Banque mondiale datant de 2023, 67 % de la population syrienne est pauvre et 25 % extrêmement pauvre (l'extrême pauvreté n'existait pas avant 2011). La livre syrienne s'est dépréciée de 50 fois entre 2011 et 2024 (le taux de change actuel est de plus de 2 500 £ pour un dollar), avec une inflation annuelle des prix à la consommation de 100 % en moyenne ces dernières années (93 % en 2023). Globalement, selon la Banque mondiale, le PIB de la Syrie a chuté de plus de 50 % au cours des années de guerre, passant de 55 milliards de dollars à environ 20 milliards de dollars entre 2010 et 2023. 45 % du parc immobilier du pays ont été détruits (dont un quart entièrement) ; environ 40 % des établissements d'enseignement et plus de la moitié des établissements de santé ont été mis hors service. Selon diverses estimations, 250 à 400 milliards de dollars sont nécessaires pour reconstruire le pays. Au total, 470 000 personnes ont été victimes du conflit au fil des années. Le nombre de réfugiés s'élève à 5,6 millions.
TASS/ gnews - RoZ
PHOTO - TASS/Michael Tereshchenko