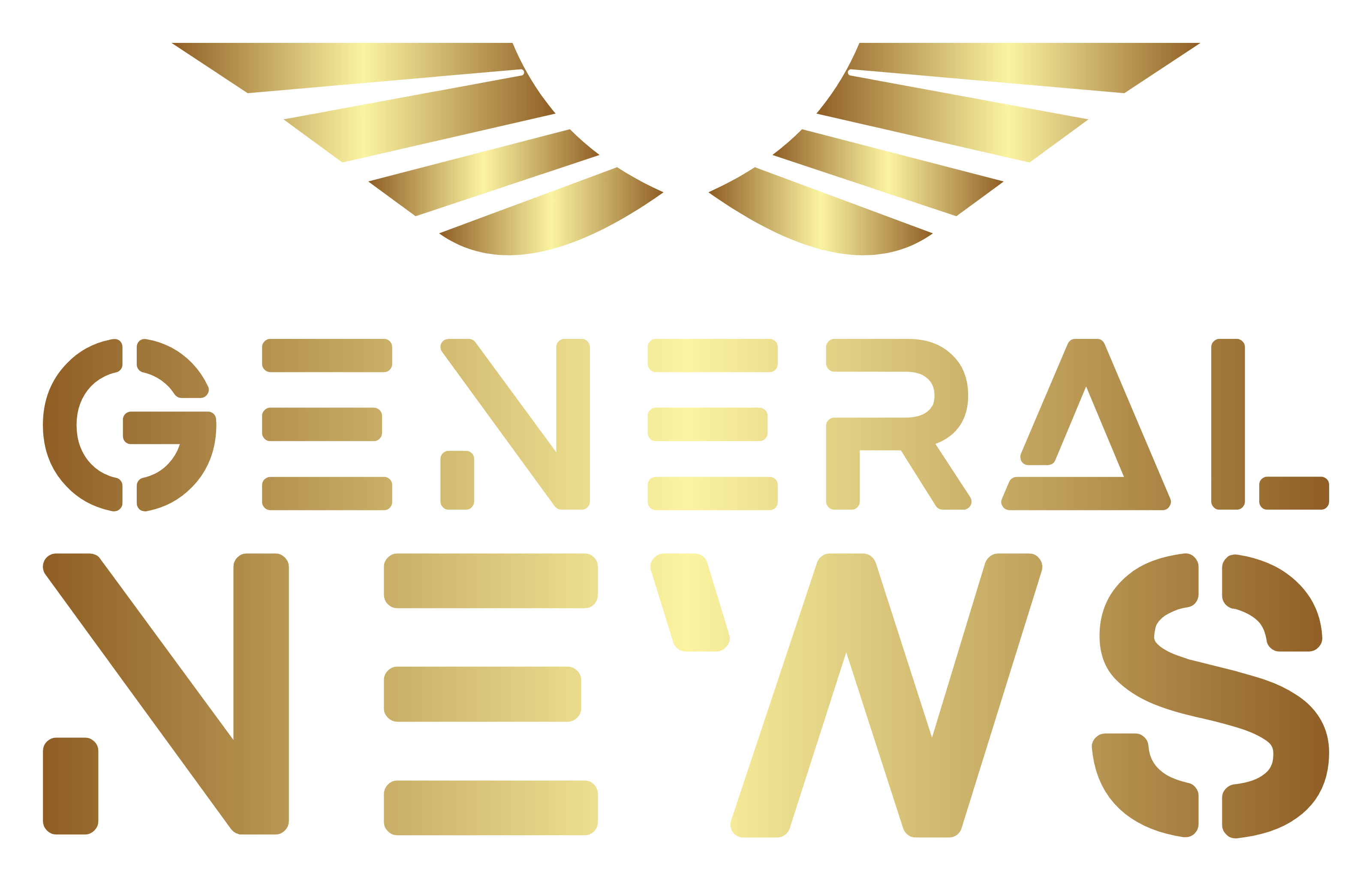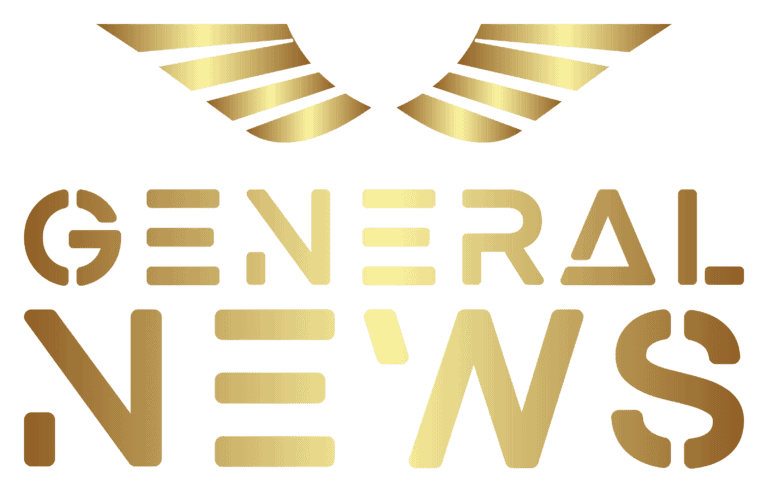Les relations entre l'Iran et les États-Unis sont durablement tendues depuis la révolution islamique de 1979 qui a renversé le Shah pro-américain. L'hostilité envers Washington est devenue l'un des principaux piliers du régime théocratique iranien. Toutefois, les difficultés économiques - en particulier l'inflation, le chômage et le manque d'investissement causés par des sanctions strictes - ont incité le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, à adopter une approche pragmatique et à soutenir les négociations avec les États-Unis, y compris avec l'administration du président Donald Trump après le retrait américain de l'accord nucléaire de 2015 (JCPOA).
Khamenei s'est montré réticent à propos de la réunion : il a déclaré qu'il n'était "ni trop optimiste, ni trop pessimiste", ce qui témoigne d'un effort pour tempérer les attentes de l'opinion publique. Néanmoins, il est clair que le résultat des négociations aura un impact majeur sur l'avenir de l'Iran, même si le régime iranien considère par la suite que les États-Unis ont violé l'accord.
Après les discussions positives qui ont eu lieu à Oman ce week-end, les attentes de l'opinion publique iranienne se sont considérablement accrues. Les deux parties ont convenu de reprendre les discussions le 19 avril, toujours à Oman.
Attentes vis-à-vis du dialogue
- Diplomatie et désescalade des tensions
L'Iran s'attend à ce que les tensions s'apaisent, en particulier après le retrait unilatéral des États-Unis du JCPOA en 2018. Téhéran vise à obtenir la levée des sanctions qui ont paralysé son économie. En revanche, Washington exige que l'Iran se conforme à nouveau pleinement au JCPOA, notamment en limitant son programme nucléaire, tout en cherchant à s'attaquer au programme de missiles de l'Iran et à ses activités dans la région, qu'il considère comme déstabilisantes.
- Concessions économiques
Le principal objectif de l'Iran est de rétablir les avantages économiques découlant du JCPOA, notamment les exportations de pétrole et l'accès aux marchés internationaux. En échange, les États-Unis attendent de l'Iran qu'il limite ses recherches nucléaires et qu'il cesse de soutenir les groupes armés désignés comme organisations terroristes.
- Garantir la non-prolifération nucléaire
L'Iran insiste sur son droit à enrichir de l'uranium à des fins pacifiques, conformément au traité de non-prolifération nucléaire (TNP). Les États-Unis, quant à eux, exigent l'arrêt de toutes les activités au-delà du JCPOA et des garanties que l'Iran ne cherche pas à se doter d'armes nucléaires.
- Stabilité de la sécurité dans la région
L'Iran exige une réduction de la présence des troupes étrangères au Moyen-Orient, en particulier des forces américaines en Irak, en Syrie et dans le golfe Persique. Il attend une reconnaissance de son influence dans ces régions. Les États-Unis souhaitent que l'Iran mette fin à son soutien à des groupes tels que le Hezbollah et le Hamas, et qu'il limite son développement de missiles balistiques.
- Droits de l'homme et réforme politique
Alors que les États-Unis font pression en faveur d'une plus grande liberté politique et de la fin de la répression de l'opposition, l'Iran rejette toute ingérence étrangère dans son système interne. Il considère les critiques sur les droits de l'homme comme une tentative de saper sa souveraineté.
Préoccupations concernant le dialogue
- Confiance et ruptures d'accords dans le passé
L'Iran craint que les États-Unis ne reviennent à nouveau sur leurs engagements - comme ils l'ont fait lorsqu'ils se sont retirés du JCPOA sous l'administration Trump. Les États-Unis, pour leur part, mettent en doute la transparence des transactions de l'Iran, notamment en ce qui concerne la recherche nucléaire militaire et le soutien aux groupes armés.
- Ambitions régionales et programme nucléaire
Les États-Unis craignent que l'Iran soit doté de l'arme nucléaire et qu'il s'ensuive une escalade nucléaire régionale. L'Iran, quant à lui, craint que les accords ne limitent son influence en Irak, en Syrie et au Liban, ce qui mettrait en péril sa position géopolitique.
- Résistance politique interne
De puissants courants politiques, tant en Iran qu'aux États-Unis, critiquent tout compromis. En Iran, les factions les plus dures refusent de céder aux exigences "impérialistes", tandis qu'aux États-Unis, l'administration est critiquée pour avoir traité avec Téhéran.
- Manque de confiance et de communication efficace
Les deux parties se soupçonnent mutuellement de tactiques et de négociations abusives pour gagner du temps ou des avantages géopolitiques. Téhéran craint que les États-Unis ne fassent que prolonger les sanctions sans faire de réelles concessions. Washington craint que l'Iran n'utilise les négociations pour couvrir le développement secret de capacités nucléaires.
- Influence des alliés et des facteurs internationaux
L'Iran se méfie de l'influence des alliés des États-Unis, en particulier d'Israël et de l'Arabie saoudite, qui, selon lui, font pression en faveur d'une position plus dure à l'égard de Téhéran. Les États-Unis craignent que la coopération croissante de l'Iran avec la Russie et la Chine ne menace leur position dans la région et dans le monde.
Conclusion
Le dialogue entre l'Iran et les États-Unis offre une occasion unique de réduire les tensions et de renforcer la stabilité dans la région, mais il comporte également des risques importants. Les attentes des deux parties - qu'il s'agisse de réformes économiques ou de garanties de sécurité - sont grevées par des griefs historiques, un manque de confiance et des pressions politiques internes. Le succès des négociations dépendra de la capacité des deux parties à surmonter leurs divergences et à conclure des accords crédibles et durables.
Par Zaheer Alam (traduit et édité par Jan Vojtěch)